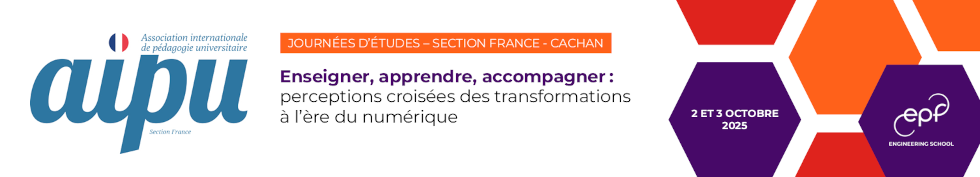L'enseignement universitaire est marqué par une hétérogénéité croissante des publics, tant en effectifs qu'en profils, avec des disparités importantes dans les conditions d'accès au numérique. Si la généralisation des outils numériques pendant la crise sanitaire a permis certains progrès, des freins subsistent : équipements inadaptés, comptes institutionnels inactifs, compétences numériques inégales, difficultés d'organisation en distanciel.
Cet article propose une analyse contextualisée de l'intégration du numérique dans plusieurs Unités d'Enseignement (UE) aux profils variés. L'objectif est de comprendre comment concevoir des dispositifs pédagogiques hybrides tenant compte de ces inégalités, afin d'assurer l'accessibilité pour tous les étudiants.
Les dispositifs étudiés combinent contenus asynchrones (vidéos, documents) et activités synchrones interactives (travail en groupe, débats). Ils reposent sur une structuration rigoureuse (annonce, ressources, accompagnement, évaluation), avec des outils accessibles sur smartphone, sans authentification obligatoire, et accompagnés de tutoriels et hotlines. La mise en petits groupes permet le partage d'écran et l'entraide.
L'accompagnement est assuré par des enseignants, tuteurs ou intervenants, et renforcé par des outils de soutien technique (FAQ, tickets, chatbot en cours de développement). Le suivi des étudiants repose sur des autoévaluations, des sondages, l'analyse des traces LMS et des retours par grille critériée. Les évaluations s'adaptent à la taille des groupes : évaluations par les pairs, soutenances, portfolios.
L'expérience montre que la qualité des interactions dépend davantage de la taille des groupes que de la modalité (présentiel/distanciel). En distanciel, la collaboration nécessite une acculturation à l'intelligence collective et des prérequis techniques. Le respect du RGPD est assuré en limitant les données personnelles sur les outils non institutionnels.